Monde du livre | Le 7 juin 2023, par Raphaël Deuff. Temps de lecture : vingt-six minutes.
« Humanités numériques »
Stéphane Plet, directeur de production : « Pour moi, le plaisir du travail a toujours été dans la variété »
Entretien sur la fabrication des livres
À la tête du bureau d’études au sein du groupe Humensis entre 2017 et 2021, Stéphane Plet est actuellement directeur de production chez Ellipses. Son parcours, riche d’un grand nombre de métiers de la chaîne du livre (mise en page, prépresse, fabrication, gestion des actifs, etc.), a également traversé la révolution numérique, qui commence à poindre dans l’édition et les métiers de l’imprimé au début des années 1990. Échange avec un professionnel « touche-à-tout » et un consultant aux compétences et aux connaissances transversales, attiré par la maîtrise technique, et marqué par l’incroyable évolution du monde du livre, de la fin du siècle dernier à aujourd’hui.
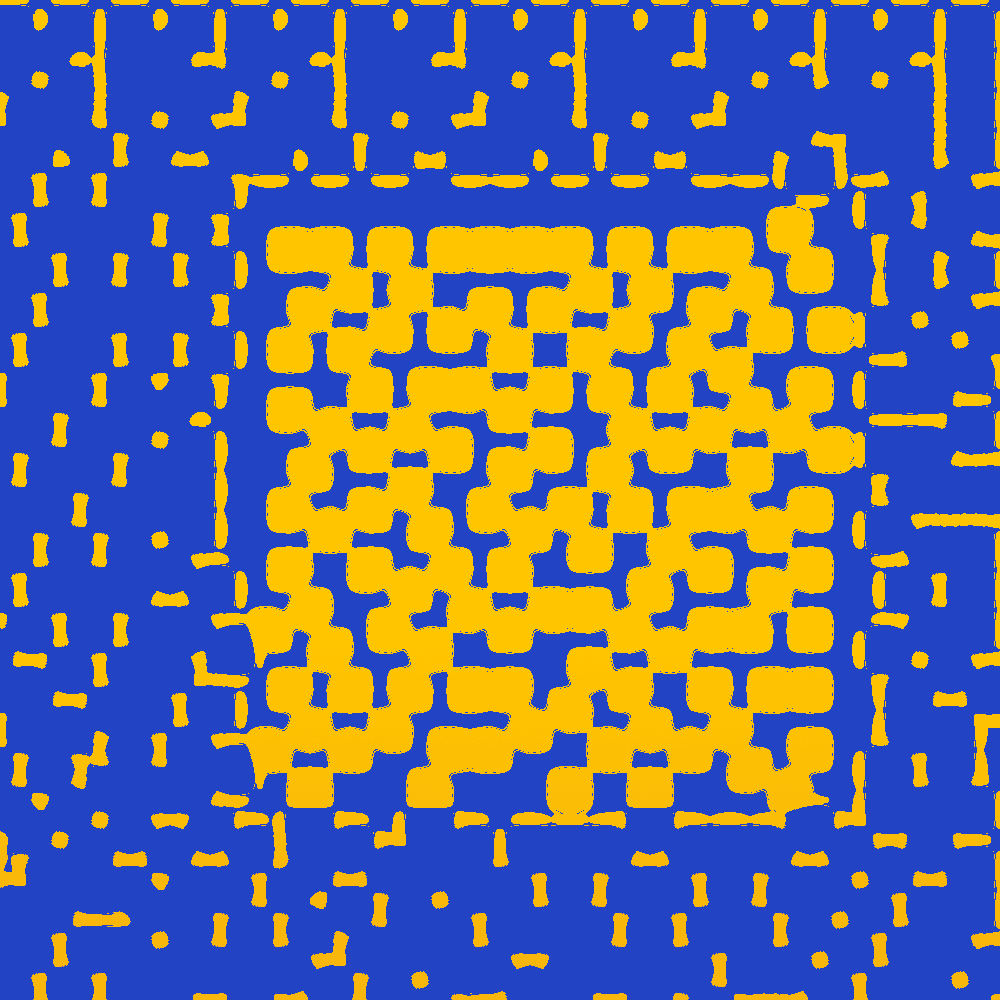
Raphaël Deuff. — Stéphane Plet, vous dirigez actuellement le bureau d’études du groupe Humensis, après être intervenu, tout au long de votre parcours, dans les départements graphiques d’un grand nombre d’entreprises assez différentes : département de fabrication, de création graphique – ce qu’on appelle couramment la « maquette » –, mais aussi dans les branches achat ou supervision, ce qui vous donne une expertise approfondie et surtout assez unique de la conception des livres. Avant d’en venir à votre rôle chez Humensis, pourriez-vous revenir sur votre parcours professionnel dans l’industrie du livre et des imprimés ?
Stéphane Plet. — Je dois dire que j’ai un parcours atypique. Je n’ai pas suivi de longues études, puisque j’ai débuté dans l’édition – chez Robert Laffont – à l’issue d’un BTS de fabrication obtenu auprès de l’Asfored. Après une année en remplacement à la fabrication, j’ai navigué au sein du département et j’ai notamment eu l’occasion de faire de la maquette – qui se faisait, à l’époque, sans aucun outil numérique – et c’était quelque chose qui me plaisait assez. On faisait les maquettes « en bleu1 », on découpait, on recevait des bandes de compo de la part du compositeur… Un travail assez amusant à faire. Puis, j’ai effectué une année de service national à l’armée de l’air, dans un département de production graphique – très bien équipé pour l’époque – où l’on préparait des dossiers pour l’état-major de l’armée de l’air. Cela comprenait un travail de mise en page, de dessin, de réalisation de graphiques, etc. C’est à ces occasions que j’ai commencé à m’intéresser à la mise en page.
Suite à cela, donc, j’ai travaillé en agence de communication, à la fois comme graphiste et en me servant de mes compétences en fabrication. J’ai travaillé d’abord chez une agence appelée Bottin Direct, qui regroupait un ensemble d’agences de marketing direct (conception et réalisation graphique) pour le compte de petites et moyennes entreprises. Je faisais alors de la conception graphique pour l’agence dans laquelle je travaillais, et je m’occupais également de fabrication pour l’ensemble des agences : c’est-à-dire que j’étais l’intermédiaire avec les imprimeurs, et que je gérais tout ce qui touche à la fabrication, comme le choix du papier, les différents façonnages… L’entreprise ayant périclité, j’ai ensuite exercé au sein d’une autre petite agence de communication (Avalone), avec là aussi une production assez diversifiée – qui allait de Disney au domaine médical, et à toutes sortes de productions pour les journaux ou la publicité : j’ai par exemple fait de la conception d’emballages de médicaments pour des laboratoires pharmaceutiques.
Je m’occupais là encore à la fois de la maquette et de la fabrication, et je me rendais également utile par mes compétences en informatique, un domaine qui m’intéressait par ailleurs beaucoup. J’ai d’ailleurs toujours été dans cette idée de varier les plaisirs, d’être un peu touche-à-tout, et m’intéressant à plusieurs domaines. En outre, l’agence s’était équipée d’une machine pour faire des films, pour « flasher » des plaques offset, une machine à chromalins (tous ces travaux étaient analogiques à l’époque). J’ai donc fait du scan pour la photogravure, encore beaucoup de maquettes, toujours de la fabrication. J’avais fait un peu le tour des procédés et j’avais envie de revenir au livre ; c’est à ce moment-là que j’ai rejoint Flammarion, en tant que responsable de fabrication du département jeunesse – dont les fameux albums du Père Castor. Mais en réalité, le directeur de production qui m’avait embauché à l’époque avait une idée derrière la tête, et très rapidement, il m’a proposé de participer à un service de production graphique en interne, où je me suis mis à faire à nouveau de la maquette.
r.d. — Quel était votre rôle ? La création de nouvelles collections ?
s.p. — En réalité, le poste était plutôt tourné vers l’informatique. J’ai certes d’abord fait de la refonte pour les Castor poche, ou le poche Jeunesse Flammarion, par exemple ; mais très vite, j’ai été intégré, au-delà du secteur jeunesse dont j’ai cessé de m’occuper, à un service, créé à ce moment-là, d’informatisation et de production au format SGML, qui est l’ancêtre de l’actuel Extensible Markup Language (XML). En d’autres termes, il s’agissait de faire de la structuration de contenu.
Parmi les collections ou grands départements, nous avions notamment Flammarion Médecine (ancienne Bibliothèque des connaissances médicales), qui produisait de très gros volumes, et il y avait aussi beaucoup de catalogues d’exposition ; l’idée était de faire également travailler les éditeurs, en amont, sur des textes structurés, des sortes de livres numériques, afin d’effectuer une mise en page en partie automatique.
J’ai aussi travaillé sur la base de données photographique, puisque Flammarion a édité et édite beaucoup de beaux livres.
r.d. — Lorsque vous parlez de base de données photo, de quoi s’agissait-il exactement ?
s.p. — Il s’agissait d’un Digital Asset Management, ou DAM : toutes les photographies étaient numérisées, et il s’agissait de gérer ce fonds, afin de pouvoir l’utiliser dans tel ou tel projet d’ouvrage. Les fichiers étaient embarqués dans une base de données avec de la métadonnée, des mots-clés, dont s’occupait ma collaboratrice ; moi, je gérais l’aspect informatique. J’étais en lien avec la société suisse allemande qui nous avait fourni le logiciel, et qui régulièrement opérait un suivi, des mises à jour, etc.
Il y avait donc cette gestion d’un côté, et puis de la mise en page, de la fabrication… Dans le même temps, une de mes préoccupations constantes était de déterminer la façon dont on pouvait améliorer la communication entre les différents acteurs de la chaîne du livre, en particulier avec les imprimeurs – puisque j’étais intégré à un service de fabrication, spécifiquement. À l’époque, les échanges de fichiers avec les imprimeurs pouvaient se faire avec un logiciel qui s’appelait Numéris ; c’était vraiment l’ancêtre du Web, des envois actuels en File Transfer Protocol ou FTP, etc.
J’ai fait mettre en place un système afin de pouvoir communiquer, envoyer les fichiers numériquement aux prestataires – puisqu’avant cela, tout se passait par des envois via coursiers : il y a d’abord eu les films, évidemment, mais ensuite ont été développé de petits supports informatiques qu’on appelait Equest ou Zip, qui étaient l’équivalent de petits disques durs.
r.d. — C’est le tout début de la chaîne informatique du livre !
s.p. — Tout à fait ! Enfin, vers la fin de l’année 1999 j’ai été recruté par la maison Belin. La maison m’a proposé un poste au sein du studio graphique, pour le réorganiser à la fois dans ses modes de production, et, là encore, dans son archivage : il y avait un gros gros besoin, puisque leur base était constituée d’un très grand nombre d’éléments éparpillés et sauvegardés à droite et à gauche, sans réelle cohérence. Par ailleurs, pour ce qui était de réorganiser la production du studio, il s’agissait d’étudier les outils avec lesquels les graphistes travaillaient, ceux avec lesquels ils auraient pu travailler plus avantageusement, à mettre à jour les logiciels, changer les processus, les améliorer, le tout principalement dans une perspective de meilleure transmission à la fabrication. Tout cela s’est fait petit à petit par une réflexion, des échanges… Il s’agissait également – puisque j’avais acquis cette expérience chez Flammarion – de faire travailler les éditeurs, en amont, sur du texte structuré, et donc leur fournir des outils – que j’ai développés : de petites macro-définitions en Visual Basic ou bien des expressions régulières, dans Word, par exemple – pour pouvoir travailler un texte de façon automatisée, et appliquer des feuilles de styles beaucoup plus rapidement…
r.d. — Donc, d’une certaine manière, c’était déjà presque un poste de bureau d’études – ou, dit plus simplement, un poste qui réclamait, disons, une vision transversale de chacun de ces métiers assez différents – en l’occurrence ceux de la chaîne du livre ?
s.p. — Oui, on peut dire ça. L’idée était de mieux assembler, de faire que les rouages de l’ensemble de la chaîne fonctionnent mieux, soient mieux huilés ; qu’il n’y ait pas de grain de sable, c’est-à-dire pas de perte d’énergie. Je répétais toujours mon « mantra » à chacun de ceux avec qui j’ai été amené à travailler : il vaut mieux passer un certain temps pour trouver une solution générique à un problème, plutôt qu’effectuer des actions répétitives. Autrement dit, plutôt que de faire cent cinquante fois la même petite opération, passons du temps pour réfléchir à une façon de l’automatiser, et ainsi disposer d’un outil qui soit un gain de temps important pour tout le monde.
r.d. — D’ailleurs entre les services eux-mêmes, ne peut-il pas y avoir des pertes d’information, des choses qui sont refaites en double, etc. ?
s.p. — Bien sûr. Des choses qui sont faites en double ; ou encore des choses faites de manière inutile, au sens où l’énergie du salarié n’est pas employée à bon escient : par exemple, pour un éditeur, le fait de passer énormément de temps à faire un travail répétitif dans Word pour supprimer des espaces, appliquer des feuilles de style (au lieu de se concentrer intellectuellement sur son texte pour le retravailler), et ce alors qu’il peut y avoir des moyens de le faire beaucoup plus rapidement, via des scripts.
Même chose pour un graphiste : quand je suis arrivé chez Belin, le graphiste importait son texte, sans récupérer les feuilles de style ; il perdait ainsi les mises en valeur qui existaient dans le texte, et passait beaucoup de temps à les reproduire dans sa maquette.
Il vaut donc mieux essayer de travailler le plus possible, dès l’abord, avec tous ces automatismes, avec toutes ces « macros », tous ces petits outils qui permettent de gagner ce temps pour se concentrer, l’éditeur sur le fond, le graphiste sur la forme, et faire véritablement le travail pour lequel chacun est employé.
Est ensuite venu s’ajouter à ça – parce que j’avais cette expérience assez variée –, chez Belin, la gestion du prépresse : par exemple, tout ce qui concerne la photogravure, le travail de l’image, et puis aussi la gestion des prestataires, des plannings de composition et de mise en page externalisée – puisqu’à côté du studio en interne beaucoup de choses aussi se faisaient à l’extérieur, chez des prestataires. Il s’agissait pour beaucoup de composition de textes scientifiques. Par exemple, pour composer des ouvrages de mathématiques, mieux vaut utiliser le LaTeX, qui est un langage de structuration très utilisé par les enseignants et les universitaires dans cette discipline. Il s’agissait alors de trouver un prestataire qui connaisse le LaTeX, qui sache le manipuler suffisamment bien pour réaliser de la mise en page. D’autant plus que sur le plan de la syntaxe, le LaTeX est réputé pour la beauté de ses formules, ce qu’apprécient beaucoup les mathématiciens. À l’inverse, en envoyant ce type de documents à un prestataire qui ne connaîtrait pas ce langage, celui-ci nous aurait fait payer un transfert et une conversion, ce qui n’était pas logique, et nous coûtait d’ailleurs beaucoup d’argent.
Au fil des ans j’ai donc introduit tout un tas de choses, en suivant évidemment la très rapide évolution technologique – ainsi, nous donnions d’abord aux imprimeurs des films, puis nous sommes passés à des fichiers natifs, que ceux-ci géraient eux-mêmes ; et enfin à un format qui s’appelait le TIFF/IT. C’était un format imprimable qui existait avant le PDF : avant le format le plus célèbre de l’entreprise Adobe, il y a eu en effet un certain nombre d’étapes, dont on n’a pas toujours conscience aujourd’hui. Puis est apparu le Portable Document Format, ou PDF, qu’il a également fallu normaliser.
Ces normes se sont constituées assez vite, car il y avait un vrai besoin ; au départ en effet, la gestion de ce format pour l’impression ne ressemblait proprement à rien ; se posait notamment la question de la portabilité des couleurs, et des normes de l’organisation ISO sont venues s’ajouter aux standards préparés par Adobe. Il a fallu intégrer ces normes au niveau de la mise en page, en créant une chaîne normalisée qui soit « ISO » d’un bout à l’autre afin de fournir des fichiers réellement portables aux différents intervenants. Après cela, il y a eu des outils comme PitStop, de l’entreprise Nfocus (il y en a d’autres) qui ont permis de certifier un PDF. Tout cela a pris quelques années, et s’est vraiment opéré à partir de 2004-2005. Avant ça, il y avait bien sûr d’autres normes : le TIFF/IT, par exemple, avait une norme qui était assez complexe ; ce format coûtait très cher, et était plutôt généré par les imprimeurs à qui on donnait les fichiers natifs.
r.d. — En fait, on pourrait dire que le numérique a produit une espèce de transfert ? Car progressivement, une partie des compétences techniques ont de fait été transférées des imprimeurs vers les éditeurs ; et il y a beaucoup de maquettes réalisées en interne maintenant, alors qu’avant cela était presque impensable…
s.p. — Tout à fait ; des compétences ont été transférées vers les studios, vers les éditeurs. Avant il y avait bien sûr des graphistes au sein des maisons, mais qui se débarrassaient en quelque sorte de tout l’aspect, je dirais, technique : ils faisaient des maquettes, esthétiques, mais sans se préoccuper des normes, de l’espace de couleurs CMJN…
r.d. — Autrement dit, l’imprimeur passait son temps à « reprendre la copie » ?
s.p. — Oui, et il était éventuellement conduit à faire des retours à l’éditeur : il y avait donc beaucoup d’allers-retours entre l’imprimeur et les services de production des maisons, et l’on perdait du temps, de l’argent…
r.d. — Vous parliez tout à l’heure de l’apparition du numérique, et du rôle que ce domaine a joué, et s’apprête aussi à jouer dans l’édition. Pourrions-nous y revenir ?
s.p. — Toujours chez Belin, je me suis aussi occupé de « l’aventure » du numérique scolaire, entamée vers 2008, lorsque nous avons commencé à imaginer un manuel scolaire entièrement numérique : il s’agissait de travailler à la fois sur la conception en aval d’un produit nouveau, et sur l’adéquation, là aussi, entre ce que faisaient les différents intervenants sur les manuels scolaires. En effet, on passait là brutalement d’un manuel au format papier – le graphiste travaillant sur ce support exclusif – à un travail du graphiste à destination de ces deux formats à la fois, papier et numérique.
r.d. — Est-ce qu’il s’agissait des tout premiers exemples de manuels numériques ?
s.p. — C’était parmi les premiers, oui, absolument. C’était au tout début de cette évolution, dans les années 2008-2009. Par la suite le format a évolué. Et cela n’est pas fini, car nous travaillons en ce moment à passer d’un manuel numérique dit « homothétique », c’est-à-dire construit à l’image du papier, à un véritable manuel Web, où la structure sera complètement repensée, et où l’on travaillera sous la forme de modules, d’unités pédagogiques. Dans son principe en effet, le manuel scolaire s’appuie beaucoup sur le format de la double page : il est construit sur ce rythme spécifique, qui est celui d’un grand nombre d’ouvrages de consultation ; on retrouve par exemple une double page de cours, une double page d’exercices, etc., et l’on articule les éléments du livre de cette façon. Il a été très difficile de sortir de ça. À l’inverse, internet est construit à travers des liens, des modules… Il s’agit en somme d’unités plus réduites, et c’est en général ce vers quoi on tend dans l’édition scolaire ; chez Belin Éducation, par exemple, cela s’appelle Manuel Max, mais aujourd’hui tous les éditeurs scolaires vont vers ce format.
Pour terminer sur mon parcours, quand la fusion entre les Presses universitaires de France (PUF) et Belin a eu lieu, Sylvie Marcet, qui était P.-D.G. de Belin, est restée à la tête du groupe, et Frédéric Mériot, l’ancien P.-D.G. des PUF, est devenu directeur général délégué ; il s’est occupé notamment de tout ce qui était production – mais aussi de la Direction des systèmes informatiques (DSI), de la comptabilité, etc. C’est dans ce cadre-là que j’ai rencontré M. Mériot, qui m’a proposé de travailler aux appels d’offres en fabrication, et donc de revenir à ce département, avec toutefois un angle plus commercial : il s’agissait de gérer les appels d’offres auprès des imprimeurs, des compositeurs, des photograveurs, etc.
C’est un peu un rôle d’état des lieux, permettant de déterminer comment nous nous situons par rapport au marché. Au moment de la fusion, nous avons par exemple consulté un certain nombre d’imprimeurs en disant : voilà ce qu’on produit, en donnant aux prestataires des tableaux que j’avais conçus, et en leur demandant d’y rentrer des prix pour les différents produits. Nous les avons ensuite comparés les uns aux autres, fait des choix, en attribuant par exemple telle ou telle collection à tel imprimeur, en fonction des tarifs. Même chose pour la photogravure ou le travail de l’image, pour la composition, etc. Et, en parallèle, je continuais mes activités prépresse, et mes productions de manuels numériques. Ce fonctionnement a duré jusqu’à ce que Frédéric Mériot me propose, à la suite d’un départ, une partie des fonctions de ce qui devait former le bureau d’études du groupe.
r.d. — En plus de tout le reste ?
s.p. — En plus. Enfin, ce n’est pas tout à fait vrai : j’ai par exemple abandonné tout ce qui était prépresse. Nous avons ainsi conçu un poste avec toujours cette attribution des appels d’offres, et aussi une part de production. C’était surtout, dans l’esprit, un poste un peu « à la carte » en fonction des besoins, pour tout sujet un peu spécifique ou transversal, et dont on ne saurait pas vraiment à qui le confier.
r.d. — Il s’agit donc, si je vous comprend bien, d’étudier des outils, des solutions pour le groupe, que ce soit dans le domaine de la gestion ou dans celui de la production des ouvrages et des contenus ? Par exemple, est-ce que votre rôle au sein du bureau d’études concerne aussi les produits, la réalisation des livres papiers ou numériques des différentes maisons du groupe ?
s.p. — Je ne suis pas éditeur – sauf peut-être pour les Ozalids d’Humensis, qui sont au reste vraiment un cas particulier. Mon travail concerne plutôt des aspects relativement techniques. Par exemple, il peut s’agir de la mise en place d’un Data Asset Management (DAM), qui regroupe les actifs numériques du groupe, les contenus textuels ou les images par exemple. Ou bien de travailler sur la base articles, que l’on appelle chez nous le Product Information Management (PIM)… Dans l’ensemble, cela concerne un assez grand nombre de sujets : il y a ainsi des choses qui touchent à l’administration des ventes (ADV). J’ai par exemple travaillé sur la distribution des titres du groupe au Canada, avec la mise en place d’un système d’impression sur place ; même chose avec le continent africain… Par ailleurs, certains sujets sont en quelque sorte annexes, ou ne sont pas forcément des sources de revenus très importantes ; à ce titre, ils ne sont pas une priorité pour la direction commerciale ou pour l’ADV. L’idée du bureau d’études est que j’initie des processus, que je les mette en place et, une fois que ça fonctionne, que je puisse les transmettre au service concerné. Et en fin de compte, la somme de toutes ces recettes finit par faire un petit chiffre…
r.d. — Vous parliez des Ozalids d’Humensis. De quoi s’agit-il exactement ?
s.p. — Cela fait partie des sujets un peu plus curieux de mon poste. Frédéric Mériot s’est rendu compte que l’on « perdait » des auteurs, ou bien des manuscrits, parce qu’il s’agissait de textes, certes intéressant sur le fond, mais commercialement parlant trop difficiles. Pour autant, par la mission culturelle que s’est donnée le groupe Humensis, il semblait pertinent de les publier ; il pouvait aussi s’agir d’auteurs qui, à l’avenir, auraient pu trouver place dans des collections plus classiques du groupe.
L’idée était donc de créer une maison, qui s’est appelée les Ozalids d’Humensis, et de dire aux auteurs : votre texte nous intéresse, nous allons le publier, mais il faut nous aider. L’idée est qu’ils achètent un petit nombre d’ouvrages (une part du tirage) afin de couvrir les frais de production – en contrepartie de quoi, nous assurons une diffusion-distribution classique. Il y a ainsi un vrai contrat d’auteur, une diffusion en librairie – les ouvrages sont gérés chez Union Distribution (UD) – exactement comme pour les autres titres des maisons du groupe. Et, de son côté, l’auteur signe également un contrat d’auteur classique (c’est de l’édition à compte d’éditeur), qui est assorti d’un contrat de commande, où il acquiert, disons, 150 à 250 exemplaires.
Nous avons par exemple été contactés par l’association des anciens élèves de HEC (École des hautes études commerciales), qui souhaitait faire un livre de témoignages sur la gouvernance d’entreprise – un sujet assez pointu, donc. Dans ce cas, je prends tout en charge : établir un modèle économique, faire préparer les contrats, éditer le texte – je ne suis bien sûr pas éditeur de formation, mais j’ai acquis assez d’expérience pour relire un texte et y relever les erreurs éventuelles, proposer des ajouts ou des reformulations, etc. – et ensuite effectuer le travail de mise en page, de suivi éditorial, de maquette, puis éventuellement de distribution ciblée, en travaillant par exemple avec une entreprise de publipostage…
Finalement, nous nous appuyons beaucoup sur le projet qui nous est proposé, son contexte, les personnes impliquées… Au départ, il n’y avait pas d’idée préconçue sur ce que nous allions publier au sein des Ozalids d’Humensis. Peu à peu, toutefois, une direction s’est dégagée : il s’agit beaucoup d’ouvrages d’économie, ou autour du monde du travail. Nous avons par exemple des partenariats avec un organisme qui s’appelle l’Institut des études économiques sociales et techniques de l’Organisation (IESTO, domiciliée au Cnam, ndlr.) ; avec HEC également ; nous avons aussi fait un livre avec une fondation, la Fondation Éthique et Économie (créée par la Fraternité d’Abraham et l’Académie des sciences morales et politiques, ndlr.), qui travaille de même sur ces deux thématiques… Ce sont souvent des auteurs qui travaillent avec des fondations, des organismes, et qui peuvent ainsi mobiliser leur réseau.
Cela participe à rendre le groupe visible, avec parfois des succès inattendus : en fin de compte, le livre réalisé avec HEC a très bien marché, nous en avons vendu environ un millier d’exemplaires, ce qui est tout à fait honorable pour une publication aussi pointue. Et c’est d’ailleurs ce premier projet, réalisé au sein des Ozalids d’Humensis, qui a donné lieu par la suite à un ouvrage en « Que sais-je ? », Les 100 mots de la gouvernance (2015). De la sorte, des auteurs avec qui nous avions travaillé sur un mode un peu à part, et pas tout à fait habituel, ont ensuite rejoint des maisons plus classiques du groupe.
r.d. — Quelques mots, pour finir, sur le profil un peu particulier qui est celui d’un directeur de bureau d’études. À voir votre parcours, vous sembliez presque destiné à ce poste, pourrait-on dire…
s.p. — C’est vrai qu’il y a quelque chose d’assez atypique dans ma fonction, qui vient notamment du fait que j’ai touché à beaucoup de domaines, et que pour moi le plaisir du travail a toujours été dans la variété. Un défaut serait peut-être d’approfondir un peu moins chacune de ces directions.
En fin de compte, cela correspond à mon profil un peu touche-à-tout. Je pense que c’est avant tout un caractère : il y a des personnes qui sont plutôt portées dans une direction précise dont ils ne veulent pas se départir, et dont ils deviennent les spécialistes absolus, avec une connaissance incroyable d’un sujet donné – même si, dans les faits, pour un sujet donné, une spécialité, il y a souvent beaucoup d’aspects à explorer, beaucoup de postes, comme lorsqu’on parle de la fabrication ou de la DSI… Mais en ce qui me concerne, l’idée a toujours été d’être plutôt comme une sorte de consultant. Avec toujours un socle solide, une connaissance très poussée et une vraie expérience de la fabrication – mais peut-être pas au sens strict : dans le cas de la fabrication, par exemple, je ne me suis pas limité aux imprimeurs et au papier. En règle générale, il y a les graphistes d’un côté, et la fabrication proprement dite de l’autre, la technique. Mon poste est une façon de toucher à ces différents aspects.
Entretien réalisé le 29 juillet 2021, à Paris.
Raphaël Deuff
En savoir plus
Ressource : Le monde du livre dans l’encyclopédie Sambuc (sambuc.fr)
Ressource : File Transfer Protocol, ou FTP (sambuc.fr)
Ressource : Portable Document Format, ou PDF (sambuc.fr)
Notes
Note 1. Avant l’usage de l’outil informatique, les maquettes destinées à la photocomposition étaient formées de blocs de textes préalablement composés, et découpés et collés, pour constituer les pages du livre, sur des tables de montage.
Entités nommées fréquentes : Humensis, Flammarion, Belin, LaTeX, PDF, Ozalids d'Humensis, HEC.
L’actualité : derniers articles
Sciences humaines
Langues isolantes, agglutinantes et flexionnelles
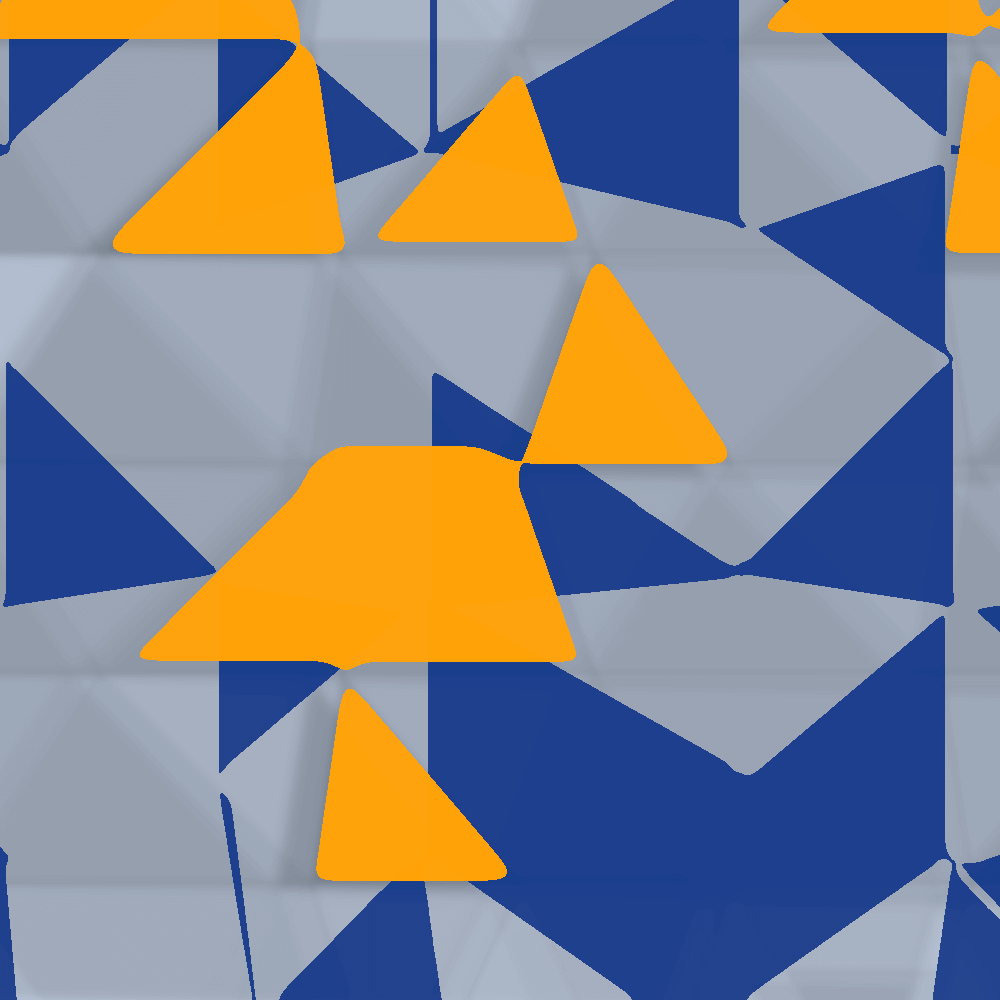
Actualités culturelles
Québec et édition francophone : le festival Livre Paris 2024 s’est ouvert pour trois jours

Actualités culturelles
Manuscrits, incunables : deux collections d’ouvrages de la Renaissance mises en vente à Lyon
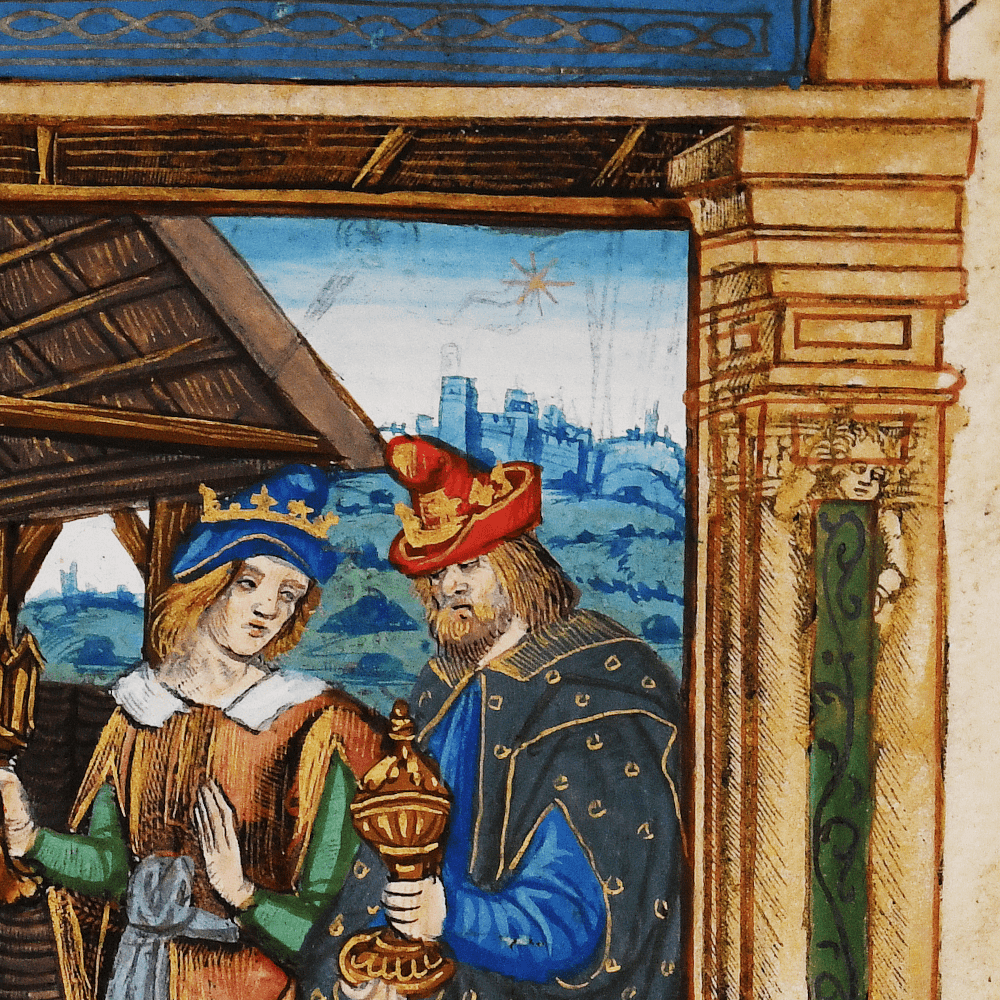
Rechercher un article dans l’encyclopédie...